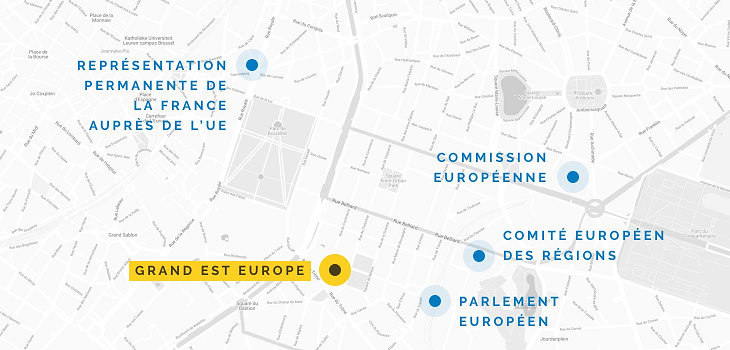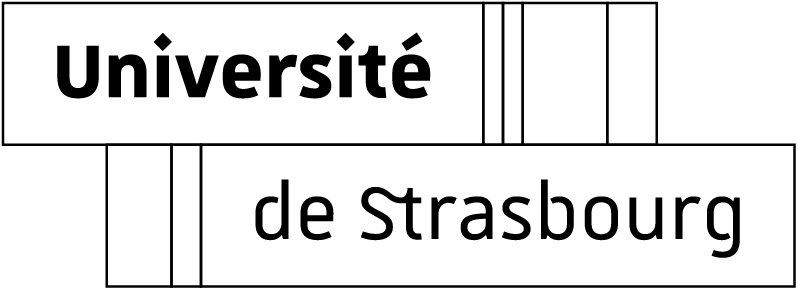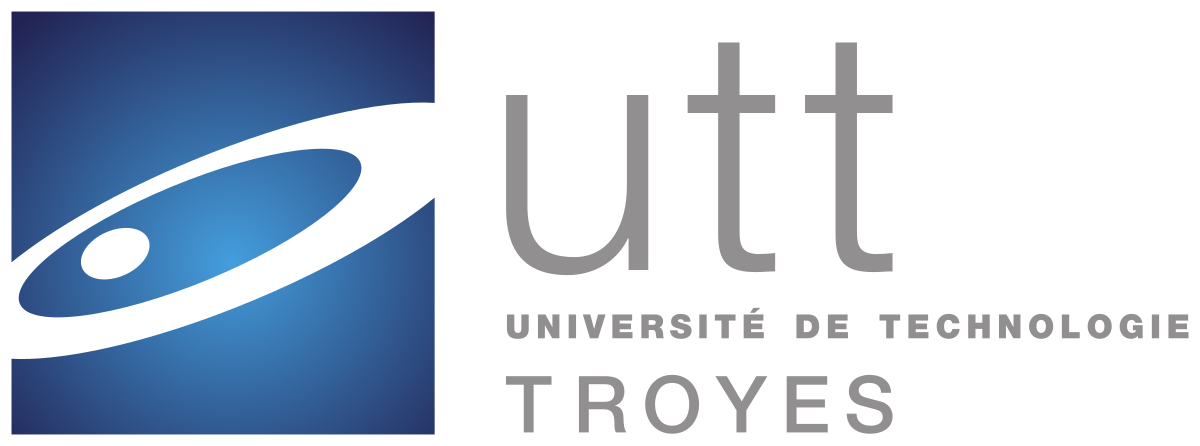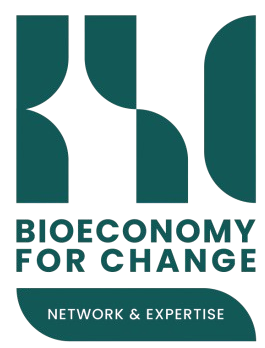La gestion durable des forêts, un sujet clef pour l'avenir
La gestion durable des forêts, un sujet clef pour l’avenir
Publié par Gaëtan Claeys le lundi 14 décembre 2020
Environnement, climat et santéLe 8 octobre dernier, le Parlement européen a adopté un rapport d’initiative sur la stratégie forestière de l’UE, datant de 2013, puis mise à jour en 2018, renouvelant ainsi ses objectifs pour l’après 2020 en vue de la rendre conforme aux objectifs du Pacte Vert.
Les forêts, la filière bois et la bioéconomie jouent un rôle crucial dans la réalisation des objectifs du «Pacte Vert», à travers leur contribution positive en matière de climat, d’énergie et d’environnement. Cette stratégie a pour objectif principal de mettre un terme à la déforestation, d’encourager le reboisement, la gestion durable des ressources forestières et une meilleure prise en compte de ces enjeux au niveau mondial.
Pour les députés européens, l’adoption d’une bioéconomie circulaire doit notamment être encouragée par des politiques de recherche et d’innovation fortes. Il est en effet estimé que chaque euro investi dans la recherche et l’innovation dans ce domaine génère une valeur ajoutée d’environ 10 euros pour les Européens.
Ce sujet est très important pour le Grand Est : les forêts y couvrent 1,9 million d’hectares, soit près d’un tiers du territoire, et sont « les plus productives de France » selon l’Office National des Forêts. À ce jour, trois d’entre elles ont déjà reçu le label « Forêt d’Exception », la forêt de Verdun, de Haguenau et celle de la Montagne de Reims. Soulignons que la filière représente près de 55.000 emplois dans l’ensemble de la chaîne de production. Par ailleurs, la bioéconomie est reconnue depuis 2017 comme l’un des deux piliers du développement économique du Grand Est, la région se voulant leader européen sur le sujet.
Retour au blog Partager : Facebook Twitter
Vers une vague de rénovation des bâtiments
Publié par Gaëtan Claeys le lundi 14 décembre 2020
Économie, industrie, énergie Environnement, climat et santéLa vétusté de la majorité des bâtiments européens (75% sont jugés inefficaces en termes énergétiques) représente à la fois un défi en termes énergétiques (40% de la consommation énergétique de l’Union) et donc climatiques, mais aussi une vraie opportunité en termes de relance économique, d’emploi (potentiel de 160 000 emplois verts) et de conditions de vie si ces bâtiments sont rénovés dans les années à venir. C’est le constat que la Commission européenne vient de dresser dans le cadre de sa stratégie « une vague de rénovations pour l’Europe », présentée le 14 octobre dernier et soumise aux commentaires des autres institutions européennes. En effet, à ce rythme, la réduction des émissions de carbone du secteur de la construction prendrait « des siècles » avant d’atteindre la neutralité climatique…
La Commission européenne se fixe donc un objectif minimal de doublement du taux annuel de rénovation énergétique des bâtiments, soit la rénovation de 35 millions de bâtiments d’ici 2030. Pour ce faire, elle envisage une série de mesures pour les années à venir, dont notamment :
- Révision des directives énergies renouvelables, efficacité énergétique et énergies et performance énergétique des bâtiments pour augmenter les objectifs, définir des normes énergétiques plus exigeantes et cibler un plus grand nombre de bâtiments (ex. possible audit énergétique pour hôpitaux, écoles et bureaux)
- Soutien financier à travers les plans de relance nationaux abondés par les crédits européens, utilisation des fonds régionaux (FEDER, FEADER), InvestEU, les initiatives de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et une simplification des règles en matière d’aides d’Etat
- Formation professionnelle à la construction durable et autres compétences nécessaires à la mise en œuvre de cette vague de rénovations, notamment à l’aide du FSE+ et du Fonds de Transition Juste
- Soutien aux Etats membres pour la mise en place de guichets uniques au niveau national, régional ou local
- Enfin, la Commission européenne propose de lancer un « nouveau Bauhaus européen » en vue de « réinventer le mode de vie durable du futur » et d’allier durabilité et style du bâti.
En termes de méthode, la Commission européenne définit trois axes prioritaires : la lutte contre la précarité énergétique, la décarbonation des systèmes de chauffage et de refroidissement (responsable de 80% de la consommation énergétique des bâtiments) et enfin la rénovation des bâtiments publics (administrations, écoles, hôpitaux), avec la possible définition de critères pour des marchés publics écologiques ainsi que de jalons indicatifs en matière de rénovation des bâtiments publics pour 2030 et 2040. Ainsi, les collectivités territoriales feront partie des acteurs directement concernés par ces nouveaux objectifs en matière de rénovation énergétique des bâtiments.
Plusieurs acteurs du Grand Est ont d’ores et déjà commencé à montrer la voie avec Oktave, le service mis en place par la Région Grand Est et l’ADEME, en coopération avec l’Union européenne et la Banque Européenne d’Investissement, pour faciliter et accélérer les démarches en matière de rénovation énergétique des logements. La «vague» en provenance de Bruxelles devrait atteindre le Grand Est l’année prochaine et amplifier les initiatives existantes, contribuant de façon importante à la lutte contre le changement climatique..
Retour au blog Partager : Facebook Twitter
Stratégies « De la ferme à la table » et « Biodiversité »
Publié par Gaëtan Claeys le vendredi 11 décembre 2020
Agriculture, affaires sociales, emploi Environnement, climat et santéPrésentées simultanément le 20 mai dernier par la Commission européenne, ces stratégies complémentaires se fixent comme objectifs de soutenir « un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement » et de « faire revenir la nature dans nos vies » afin d’atteindre les objectifs ambitieux du pacte vert européen (Green Deal).
De la ferme à la table
D’ici 2030, la stratégie de la ferme à la table compte atteindre 25% de surfaces agricoles consacrée à l’agriculture biologique; une réduction de 50 % de l’utilisation des pesticides chimiques, et plus particulièrement des pesticides les plus dangereux ; une baisse de l’utilisation d’engrais d’au moins 20% et réduire d’au moins 50% les fuites de nutriments et la pollution à l’azote et au phosphore. Elle prévoit aussi de garantir l’accès au haut débit à toutes les zones rurales d’ici 2025 pour mieux intégrer le numérique dans une gestion précise et précautionneuse des entrants agricoles.
Les objectifs seront fixés avant la révision de la PAC, en cours de discussion, afin que cette dernière puisse les intégrer. La commission a d’ailleurs publié un rapport d’analyse des liens entre le Green Deal et la PAC. Celle-ci demeurera un levier central pour accompagner les agriculteurs dans cette transition, notamment les futurs «programmes écologiques » du 1er pilier pour stimuler les pratiques durables. Les États membres et la Commission devront veiller à ce que ces « éco-schémas » soient dotés des ressources appropriées et mis en œuvre dans le cadre des futurs plans stratégiques, avec idéalement un budget minimal spécialement affecté.
Coté nouveautés, la Commission a annoncé un système d’étiquetage plus précis en matière de valeurs nutritionnelles afin de limiter la consommation d’aliments moins sains.
Elle compte également promouvoir les pratiques agricoles réduisant les émissions de CO2 telles que la bioéconomie circulaire. 10 milliards d’euros seront consacrés dans le cadre du futur programme Horizon Europe à la recherche et l’innovation, à l’alimentation, à la bioéconomie, aux ressources naturelles, à l’agriculture et à l’environnement, ainsi que le recours aux technologies numériques dans le secteur de l’agroalimentaire. Le futur fonds InvestEU aura pour objectif de permettre également d’encourager les investissements dans le secteur agroalimentaire en facilitant l’accès des PME et des entreprises de taille intermédiaire.
Plusieurs régulations seront également revues afin d’atteindre ces objectifs, concernant les dates limites de consommation des produits, les emballages alimentaires et les règles de concurrences dans le but d’établir des initiatives collectives pour accompagner les acteurs de l’approvisionnement alimentaire et les consommateurs dans la transition.
Stratégie sur la biodiversité
La « stratégie sur la biodiversité » ambitionne, afin de faire face à la dégradation des écosystèmes, d’aboutir à la transformation d’au moins 30% des terres et mers d’Europe en zones protégées gérées efficacement ou la mise en oeuvre d’un plan de restauration de la nature qui comprend les éléments suivants:
- Planter 3 milliards d’arbres supplémentaires d’ici 2030
- Restaurer 25.000 km de rivières
- Améliorer l’état ou la conservation d’au moins 30% des habitats et espèces protégées,
- Lutter contre l’introduction d’espèces invasives exotiques
- Lutter contre le déclin des oiseaux et insectes, plus précisément les pollinisateurs
- Faire en sorte qu’au moins 10 % de la surface agricole consiste en des particularités topographiques à haute diversité biologique.
Afin de faire face aux importants besoins financiers, la Commission entend s’appuyer sur le renforcement des investissements publics et privés dans le cadre des programmes du prochain budget 2021-2027 de l’Union Européenne. Elle souhaite, afin d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée dans ces deux stratégies: mobiliser encore plus fortement le secteur financier vers des investissement plus durables par le biais de la taxonomie verte définissant les investissements durables et de la stratégie renouvelée en matière de financement durable.
Adoptée en pleine pandémie de COVID-19, qui a mis à rude épreuve l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire et souligné l’importance de la préservation de la biodiversité pour prévenir l’apparition de futures épidémies, se définissent comme des piliers nécessaires de la relance économique pour renforcer la compétitivité et la résilience.
Retour au blog Partager : Facebook Twitter
Plan d’action pour l’économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive
Publié par Gaëtan Claeys le vendredi 11 décembre 2020
Environnement, climat et santéCe plan vise à permettre de doubler le taux d’utilisation circulaire des matériaux au cours de la décennie à venir en accompagnant la transition du mode de consommation actuellement dominant – produire, consommer et jeter – vers un mode de consommation dit des 3R : Réutiliser Réparer Recycler.
Lors de la conception des produits, phase déterminante pour la durabilité et par conséquent l’empreinte carbone et environnementale de ceux-ci. Une initiative législative sur les produits durables, devra étendre la portée de la directive sur l’écoconception, jusqu’ici dédiée aux produits liés à l’énergie, à une large gamme de produits : amélioration de la durabilité, réutilisabilité, évolutivité dont lutte contre l’obsolescence programmée, réparabilité des produits et économie de la fonctionnalité.
Mais également à la destination des consommateurs, pour les aider à consommer des produits plus respectueux de l’environnement, grâce à des informations fiables concernant la durée de vie des produits, leur réparabilité, la disponibilité de pièce de rechanges et de service de réparation…
Le plan d’action cible plus particulièrement :
- Le matériel électronique et TICS : une initiative d’économie circulaire pour le matériel électronique sur l’écoconception des téléphones, tablettes, ordinateurs (souvent riches en minerais de conflits), les imprimantes et leurs cartouches.
- Les batteries et les véhicules : avec un nouveau cadre réglementaire pour les batteries, une révision des règles relatives aux véhicules hors d’usage, ainsi qu’un renforcement des règles relatives au contenu recyclé et des mesures visant à améliorer les taux de collecte et de recyclage de toutes les batteries, ainsi que sur les batteries non rechargeables en vue de supprimer progressivement leur utilisation, lorsqu’il existe des solutions de remplacement.
- Les emballages : augmenter la recyclabilité des différents emballages : écoconception, simplification du procédé de fabrication, transparence concernant la composition, diminution de l’utilisation de plastiques, réduction du suremballage… notamment en révisant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages
- Les matières plastiques : dans la suite de la stratégie de 2018, des mesures supplémentaires concernant les microplastiques seront prises : limitation de leur ajout intentionnel, instauration des mesures en matière d’étiquetage, de normalisation et de certification. Un cadre d’action portant sur les plastiques biosourcés, dégradables et compostables sera déployé et la Commission surveillera également la mise en œuvre de la directive sur les plastiques à usage uniques.
- Le textile : approfondissement des mesures d’écoconception, mise en place de nouveaux moyens d’informer les consommateurs, fixation par les Etats membres de taux élevés de collecte sélective des déchets textiles à atteindre pour 2025.
- La construction et les bâtiments : en plus de la stratégie Renovation Wave attendue cet automne, lancement d’une nouvelle stratégie pour un environnement bâti durable qui promouvra la circularité tout au long du cycle de vie des bâtiments, et révisions du règlement sur les produits de construction.
- Les denrées alimentaires, eau et nutriments : établissement d’un objectif de réduction du gaspillage alimentaire, action phare de ce plan d’action, ainsi qu’augmentation de la consommation et de la distribution de produits alimentaires plus durables. La suppression des emballages au profits d’articles plus durables et la réutilisation de l’eau, notamment lors de processus industriels, font également partie des objectifs pour ce secteur.
- Les substances toxiques : création de solutions de tri de haute qualité des déchets afin d’éliminer les contaminants, limitation de la présence de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement dans les matériaux recyclés, coopération avec l’industrie afin d’élaborer des systèmes harmonisés de suivi des substances considérées extrêmement préoccupantes.
L’économie circulaire étant vecteur de croissance et création d’emplois, dans le cadre de sa stratégie en matière de compétences, la Commission veillera à ce que ses instruments de soutien à l’acquisition de compétences et à la création d’emplois contribuent également à accélérer la transition.
La plateforme des acteurs européens de l’économie circulaire restera le lieu d’échange d’informations entre les parties prenantes.
Retour au blog Partager : Facebook Twitter